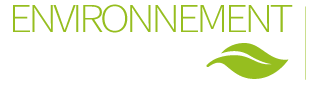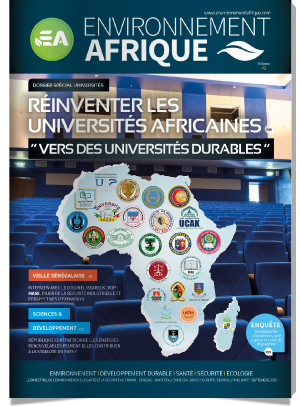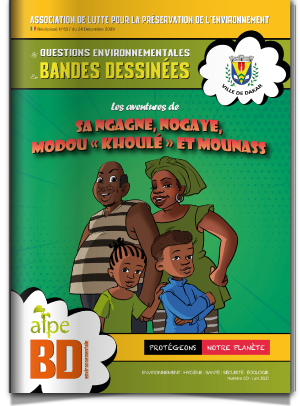Depuis la crise alimentaire de 2008, le nombre et l’ampleur des projets d’investissements agricoles à grande échelle (plus de mille hectares) ont fortement augmenté. Ils se traduisent par des achats de terre ou par des concessions de baux de longue durée. Ces acquisitions foncières sont principalement concentrées dans les pays du Sud, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne.
Ainsi, entre 2010 et 2020 en Afrique subsaharienne, 7,3 millions d’hectares sont passés sous contrat de location ou d’acquisition, dont moins de 40 % auraient finalement été mis en valeur.
Cette ruée – mondiale – sur les terres est inédite, tant par son ampleur que par ses finalités. Il ne s’agit plus seulement pour des firmes privées d’assurer leurs approvisionnements en matières premières industrielles (plantations d’hévéas de Michelin au Brésil ou de Firestone au Libéria, de palmiers à huile d’Unilever au Nigéria, etc.) ou de cultiver des fruits pour l’exportation (Dole et Del Monte en Amérique centrale ou au Cameroun, etc.).
Il s’agit pour des entreprises mais, aussi, pour des États en manque de terres arables (Libye, Arabie Saoudite, Chine, Inde, USA, pays européens) d’implanter dans d’autres pays des cultures alimentaires et des cultures énergétiques, pour garantir leur sécurité alimentaire et pallier la raréfaction des énergies fossiles.
L’Afrique est le continent privilégié de ces nouveaux investissements. Elle est généralement décrite comme disposant d’importantes réserves foncières peu ou pas valorisées.
La Banque mondiale qualifie ainsi l’Afrique de « Géant endormi » n’attendant que les investisseurs pour s’éveiller à la croissance agricole. Cette vision est discutée par ceux qui dénoncent « des accaparements fonciers ». Pour GRAIN (petite organisation internationale qui soutient la lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité), les détenteurs de capitaux financiers « arrachent » des terres productives à des populations ou à des États faibles, aux capacités d’actions (financières, politiques, sociales) limitées.
Composer ou s’opposer ?
La lutte frontale peut apparaître comme la solution la plus appropriée.
Cette stratégie a été couronnée de succès dans le cas du premier et du plus emblématique des grands cas d’appropriation foncière, celui de Daewoo à Madagascar. En 2009, l’annonce de ce projet sud-coréen portant sur plus d’un million d’hectares a fait la une de la presse internationale. Le terme d’accaparement foncier a été largement utilisé. L’impact médiatique s’explique, notamment, par le soulèvement de plusieurs milliers de personnes qui a conduit au renversement du gouvernement en place.
L’exemple est cependant peu représentatif. L’annonce du projet a été faite au moment où une lutte politique aigüe divisait le pays et opposait deux partis qui se disputaient le pouvoir. Ce n’est pas le cas dans tous les pays, où la faiblesse de l’État se combine souvent avec le contrôle très strict des politiques et du Président lui-même sur tous les leviers de commande. L’ampleur et l’irréalisme du projet étaient tels que les arguments économiques ne pouvaient pas convaincre. La transparence a été relativement grande et a nui aux promoteurs.
L’autre axe serait de demander une meilleure intégration des populations locales dans les processus d’étude et de réalisation des projets, pour garantir de réelles retombées économiques, éviter la constitution de rentes foncières et se prémunir de conséquences sociales et écologiques négatives.
Plus de 120 ONG, nationales et internationales, ont signé en avril 2010 une déclaration d’opposition aux « sept principes » pour un investissement foncier responsable, précisant qu’« aucun principe au monde ne peut justifier l’accaparement de terres ». Cette stratégie d’opposition, a cependant, sauf exceptions, beaucoup de mal à se concrétiser car les alternatives et les moyens de résister manquent aux acteurs locaux.
Peut-on imaginer de changer complètement de cadre de référence ?
Plutôt que de placer l’agriculture familiale dans une position défensive, face à l’agriculture d’entreprise, la question est peut-être de donner à l’agriculture familiale une place pleine et entière, bien définie dans les politiques publiques, correspondant à ses capacités et prenant en compte ses limites et ses besoins. L’expérience du Brésil est à cet égard intéressante.
Deux voies y ont été explorées depuis une vingtaine d’années : celle de la complémentarité économique entre agricultures familiales et exploitations agro-industrielles, mais aussi celle d’une plus grande autonomie des exploitations familiales, en les spécialisant sur le créneau de la sécurité alimentaire des campagnes et des petites villes.
En Afrique, sauf de rares exceptions, ni les États, ni les bailleurs de fonds, ni les représentants des agriculteurs familiaux n’ont réellement investi ce champ pour inventer des systèmes qui soient réellement gagnant-gagnant, ou pour faire en sorte que la plus-value soit partagée entre les deux parties d’une manière « équitable », donc durable (durable shared value, dans le vocabulaire de la Banque mondiale).
Ce manque d’expérimentations sociales est probablement lié à un manque de confiance généralisé. On revient ici à la question de la nécessité de rapports de force plus équilibrés et au besoin de régulations acceptées par tous ou imposées à tous par l’État. L’expérience du Brésil n’a pu se faire que grâce à une volonté forte de l’État d’investir dans le soutien financier aux agriculteurs familiaux, soutien qui fait l’objet d’un consensus, qui se traduit au plan politique par l’existence d’un ministère spécifique, à même de mobiliser les moyens d’un État fédéral puissant, qui dirige une des économies les plus dynamiques du monde actuel.
La question fondamentale est celle de la place future des agricultures familiales, qui existent et produisent, mais qui doivent évoluer pour subsister dans un environnement où l’accès aux marchés est indispensable, et où l’agriculture – surtout irriguée – nécessite des investissements coûteux.
En nous appuyant sur l’expérience brésilienne, nous pensons que des expérimentations sont nécessaires pour explorer, à la fois les complémentarités possibles entre agricultures familiales et entreprises et les possibilités de développement d’une agriculture familiale autonome. Les conditions de réalisation de telles expériences sont cependant à étudier au cas par cas. Dans le cas des pays les plus fragiles au plan économique et au plan institutionnel, un accompagnement extérieur semble indispensable tant les rapports de force sont déséquilibrés.
Dans cette perspective, l’action de la société civile pourrait s’organiser autour de deux axes :
- La lutte pour le respect des lois et des réglementations existantes dans le cas d’installation d’entreprises (indemnisation, compensation sociale par des infrastructures sociales)
- L’expérimentation autour des complémentarités agriculture familiale et entreprises d’une part, et sur l’autonomie des agricultures familiales, d’autre part. Cela signifie travailler avec l’ensemble des types d’agriculture familiale (et pas seulement les producteurs familiaux les plus capables de s’intégrer aux marchés internationaux), expérimenter de nouvelles solutions, sans exclusive, et soutenir financièrement et techniquement les agricultures familiales.
Par Jacques Momar NDIAYE — Src: developpementdurable.revues.org