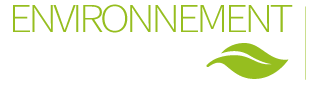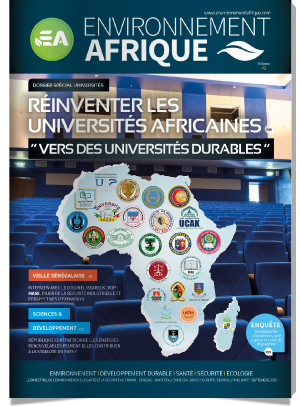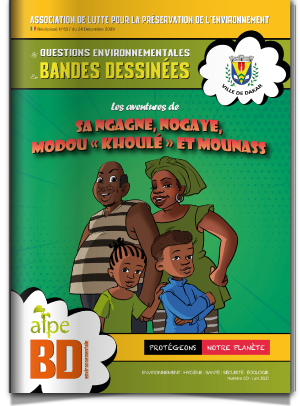Tout commence en 2011 lorsqu’une patiente d’origine guadeloupéenne est admise dans un hôpital parisien pour une chirurgie programmée. A cette occasion, elle subit une série de tests pré-transfusionnels qui révèlent une particularité étonnante : cette patiente possède dans son sang un anticorps qui réagit avec tous les types de sang testés. Autrement dit, elle est incompatible avec tous les donneurs !
Un antigène absent
Au-delà des complications que cela pourrait engendrer pour elle, le cas de cette patiente a intrigué les biologistes médicaux qui ont confié son dossier à l’EFS qui a réalisé des examens supplémentaires avec le concours de l’unité mixte de recherche UMR_S1134 – Biologie intégrée du globule rouge (Inserm/Université Paris Cité/Université des Antilles/EFS Île-de-France). Ceux-ci n’ont pourtant pas permis de résoudre le mystère autour de ce sang. « Ce n’est qu’à partir de 2019 que l’on a pu, grâce à de nouvelles techniques d’analyse de l’ADN, comprendre ce qui se passait« , souligne Thierry Peyrard. Pour ce faire, les chercheurs ont pu, grâce au séquençage à haut débit, analyser les 22.000 gènes de la patiente et y rechercher des mutations particulières sur des gènes potentiellement liés à l’expression des groupes sanguins sur le globule rouge.
C’est comme cela qu’a été identifié chez la patiente le gène PIGZ, qui était muté et dont elle avait hérité les deux mêmes versions mutées de son père et de sa mère, ce que les spécialistes appellent une mutation homozygote. Ce gène code pour une enzyme qui fixe un sucre, appelé mannose, sur une structure bien particulière à la surface des globules rouges. L’ajout de ce sucre permet la création d’un antigène sur le globule rouge, c’est-à-dire une substance capable d’induire l’apparition d’un anticorps chez une personne qui ne la possède pas. Le gène PIGZ étant inactif chez la patiente, elle est donc dépourvue de cet antigène, ce dernier ayant été baptisé Gwada, en hommage aux origines ultramarines de la patiente. La patiente est donc porteuse du phénotype « Gwada négatif », c’est-à-dire qu’elle ne possède pas l’antigène Gwada. À ce jour, elle reste la seule personne connue au monde dans ce cas.
Difficulté transfusionnelle
L’existence d’un groupe sanguin aussi rare pose un défi médical majeur : garantir la sécurité des transfusions en cas d’urgence. Or, la patiente a déjà développé un anticorps contre l’antigène Gwada, ce qui signifie qu’une transfusion classique (qui serait alors réalisée avec du sang de donneurs Gwada positif) pourrait déclencher une réaction immunitaire dont la gravité est difficilement prévisible. En dehors de l’espoir de trouver des frères et sœurs compatibles (ce qui ne fut pas le cas ici), les seules solutions sont, en dehors de l’urgence, l’autotransfusion (prélèvement du propre sang de la patiente en vue d’une intervention programmée) ou des dons classiques réguliers qui feraient alors l’objet d’une congélation au sein de la banque nationale de sang rare.
« Il est ainsi possible pour les personnes porteuses d’un groupe sanguin rare de recourir à un stock de globules rouges prélevés et congelés à -80 °C qui peuvent être conservés durant 30 ans. Mais en cas d’épuisement du stock ou d’urgence vitale, il faudrait transfuser une poche « la moins incompatible possible », avec un traitement médicamenteux adjuvant« , détaille Thierry Peyrard. C’est dans cette optique qu’un dépistage de ce groupe rare va être prochainement engagé, en ciblant d’abord les proches de la patiente, puis les donneurs guadeloupéens aux Antilles et ceux installés dans l’Hexagone. L’objectif est de constituer un registre de donneurs compatibles, en intégrant leurs profils au sein du fichier national et international des donneurs de sang rare.
Un nouveau système de groupe
Le 31 mai 2025, les résultats de cette longue enquête ont été présentés lors du congrès mondial de l’International Society of Blood Transfusion (ISBT) à Milan. Les chercheurs de l’EFS y ont vu officialiser la découverte du 48ème système de groupe sanguin qui porte le nom du gène impliqué, PIGZ, et comportant à ce jour un seul antigène, Gwada. « Ce n’est pas simplement une curiosité scientifique que de présenter un groupe sanguin rare. Pour les personnes concernées, cela peut devenir un sujet d’angoisse réelle pour leur prise en charge médicale, en cas d’hémorragie ou de grossesse« , souligne Thierry Peyrard. L’accompagnement psychologique et la sensibilisation de certaines communautés à la question des dépistages ciblés font désormais partie intégrante de la stratégie de l’EFS, afin de trouver le plus grand nombre de donneurs de sang rare et ainsi assurer la sécurité transfusionnelle de tous les patients.
Cette découverte souligne aussi que les systèmes ABO et Rh (anciennement Rhésus), bien connus du grand public, ne reflète qu’une fraction de la complexité du sang humain. On dénombre aujourd’hui près de 400 antigènes, qui sont organisés au sein de ces 48 systèmes. « Depuis 2012, 17 nouveaux systèmes ont été reconnus« , ajoute le chercheur. Parmi eux, 10 ont été identifiés par les équipes de l’EFS, qui sont particulièrement à la pointe de la recherche sur ce sujet.
Environ 200 groupes sanguins différents sont qualifiés de « rares » chez l’Homme. En France, on estime à 1 million le nombre de personnes porteuses d’un groupe sanguin rare, mais seules environ 20.000 sont connues, soit la partie très émergée de l’iceberg ! Pour assurer leur sécurité et pour que la recherche se poursuive, chaque don de sang peut se révéler d’une importance capitale. Aussi, à l’approche des vacances d’été, l’EFS est plus que jamais mobilisé dans ses différentes Maisons du Don et lors de collectes mobiles pour accueillir les donneurs.